La Guerre froide dans la 'nouvelle' RBHC
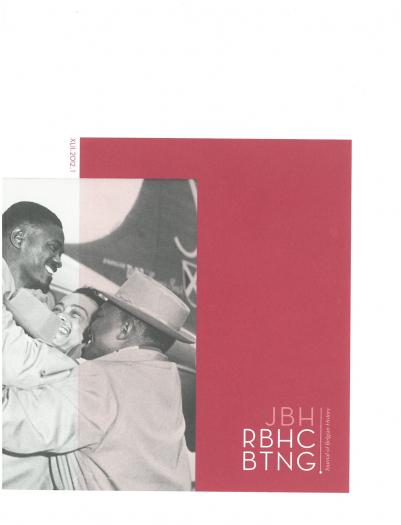
L'actuelle Revue Belge d'Histoire Contemporaine est née en 2012 de la fusion entre la revue éponyme qui l'a précédée et les Cahiers d'Histoire du temps Présent qui ont succédé aux Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale en 1997. Cette page contient un aperçu des articles relatifs à l'histoire de la Guerre froide publiés dans la 'nouvelle' RBHC. Vous pouvez retrouver le même genre d'aperçu de ce type de publications dans 'l'ancienne' RBHC ici. Et enfin, si vous cherchez des publications sur la Guerre froide dans les CHTP (et la revue qui les a précédés), vous les trouverez ici.
Dès sa première année de publication, la 'nouvelle' RBHC a immédiatement accordé une place importante à la recherche belge sur la Guerre froide. Dans chaque numéro, au moins un article a inclus le conflit comme facteur dans l'analyse.
Anne-Sophie Gijs, par exemple, dans son étude portant notamment sur les convictions idéologiques du premier Premier ministre congolais Patrice Lumumba, souligne qu'il tirait surtout parti de la bipolarité de la Guerre froide et qu'il a toujours gardé dans le vague ses affinités idéologiques réelles, afin de ne pas négliger les éventuels soutiens des deux camps (2012/1).
Frank Gerits interroge la diplomatie publique américaine via les activités du Service d'information des Etats-Unis dans le Bruxelles des années 50. Il constate qu'elle dirigeait ses activités de propagande en faveur de la participation belge à la guerre de Corée et à la Communauté européenne de défense en visant non pas tant la population que directement le gouvernement. Ce n'est que par la suite que, la société au sens large a fait l'objet de ses manoeuvres, mais cela ne s'est pas passé aussi facilement (2012/4).
Dans le numéro thématique de 2012, consacré à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, notemment les rédacteurs invités Bruno Benvindo (Les autorités du passé. Mémoires (in)disciplinées du camp de Breendonk,1944-2010) et Evert Peeters (Het gevecht tegen de tijd. Patriottische oorlogsherdenkingen als vorm van contestatie, 1945-1965 (La lutte contre le temps. Les commémorations patriotiques de guerre comme forme de contestation, 1945-1965), attribuent aussi dans leurs deux articles rédigés en solo un certain poids au conflit Est-Ouest dans la polarisation des mémoires de guerre rivales (2012/2-3).
Un an après Gijs, Vincent Genin place également ses réflexions sur la politique étrangère française vis-à-vis de la question du Congo à l'intersection de la recherche sur la Guerre froide et de la littérature sur la décolonisation (2013/1). Kim Christiaens apporte dans un numéro ultérieur une dimension de Guerre froide à l'historiographie des mouvements sociaux européens par le biais de son analyse de la mobilisation belge contre la persécution politique dans la dictature brésilienne des années 1970 (2013/4).
Au cours des années suivantes, les lecteurs de la RBHC ont pu lire plusieurs autres articles mettant en évidence la diversité des acteurs et des pratiques sur la scène internationale de la Guerre froide. Cela vaut sans doute dans une mesure moindre pour l'étude de Vincent Delcorps sur la façon dont l'appareil diplomatique belge a traité les défis du multilatéralisme (2014/4), que pour l'examen par Rafael Pedemonte Lavis des relations culturelles belges avec la Hongrie au lendemain de l'insurrection de Budapest en 1956 (2015/1).
En 2019, on retrouve un article dans la RBHC sur l'interaction entre la décolonisation et la Guerre froide, même si son auteur, Colin Hendrickx, minimise l'impact du conflit Est-Ouest sur les relations entre la Belgique et le Zaïre à l'époque de Mobutu (2019/1).
Un an plus tard, Elie Teicher rejoint plus ou moins les recherches de Christiaens en s'intéressant à l'engagement politique de l'écrivain belge Conrad Detrez, qui a séjourné longtemps au Brésil. Dans son article, Teicher ne se réfère pas explicitement à la Guerre froide, mais aux positions changeantes de son protagoniste, qui passe d'un anticommunisme catholique au début des années 1960 à sa participation aux activités d'un mouvement communiste brésilien dissident à la fin des années 1960, puis à l'abandon de cette pensée vers la fin de sa vie (2020/1).
En 2020 toujours, Thomas Briamont étudie les relations bilatérales au début de la Guerre froide afin d'évaluer le poids des différents éléments déterminants de l'élaboration de la politique étrangère. Suite aux travaux de Christoph Brüll sur les relations belgo-allemandes, il préconise un paradigme de sécurité plus large que le paradigme stratégique-militaire. Il met surtout l'accent sur la construction mentale de la menace militaire et sur la manière dont un certain nombre d'acteurs pesant sur la politique lui donnent un sens (2020/2).
L'année suivante, Bram De Maeyer fournit à la RBHC une contribution issue de sa recherche doctorale sur l'architecture des ambassades belges d'après-guerre. L'article qu'il cosigne avec ses promoteurs Fredie Floré et Anne-Françoise Morel sur la chancellerie belge à Washington illustre bien la manière dont diplomates et architectes ont collaboré au début de la Guerre froide en vue de renforcer les liens transatlantiques (2021/3).
Dix ans après le numéro thématique de Benvindo et Peeters sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, Babette Weyns souligne également qu'après une brève période de libération et de reconstruction, la Guerre froide n'a pas tardé à renforcer de manière sensible la polarisation entre communistes et anticommunistes parmi les anciens résistants (lien temporaire - 2022/1-2).
2022 est également l'année du septante-cinquième anniversaire du début de la Guerre froide. A cette occasion, Michael Auwers a publié un article de synthèse sur la manière dont les historiens belges ont étudié le conflit au cours des dernières décennies (2022/3). VOus pouvez trouver un résumé de cet article ici.